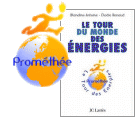
|
Les économies d'énergies - Faire mieux, avec moins
Les albums liés au chapitre
Photos de l'album "Solapur"
Au département de génie mécanique de l'Institut Technologique de Bombay (Mumbai, Inde), le professeur Rangan Banerjee nous fait part des projets auxquels son équipe et lui participent, dans le but d'accroître l'efficacité énergétique des industries traditionnelles du Maharastra. Ainsi de la mise au point de fours à verre améliorés, ou de la veille technique dans des secteurs à fort potentiel d'économie d'énergie. Son équipe est ainsi en contact avec l'association de recherche sur les textiles de Bombay (BTRA) auprès de laquelle il nous recommande.  Le Dr Matre, ingénieur à BTRA, nous invite à le retrouver à Solapur, haut lieu de l'industrie textile du Maharastra. Dans l'usine qu'il audite, il nous présente fuseau (main droite) et navette (main gauche). Le premier est inséré dans la seconde qui, envoyée à toute vitesse d'une extrémité du métier à tisser à l'autre, laissera derrière elle une longue traînée de fil à draps ou serviettes de bains.
Le Dr Matre, ingénieur à BTRA, nous invite à le retrouver à Solapur, haut lieu de l'industrie textile du Maharastra. Dans l'usine qu'il audite, il nous présente fuseau (main droite) et navette (main gauche). Le premier est inséré dans la seconde qui, envoyée à toute vitesse d'une extrémité du métier à tisser à l'autre, laissera derrière elle une longue traînée de fil à draps ou serviettes de bains.

Mais reprenons notre visite pour mieux comprendre l'aventure de ce fil à tisser. A l'extérieur de la fabrique, des coudées de fil de coton cardé sèchent. 
On en trouve de toutes les couleurs (d'ailleurs, pour être si blanc, le « blanc » est lui aussi traité), ainsi de ce rose vif tout juste sorti de l'armoire à teindre et en route vers les tréteaux de séchage... 
... ou de ce jaune poussin. Une fois séché, ...  ... le fil est mis en fuseaux.
... le fil est mis en fuseaux.

En bobines, ... 
... et en fuseaux ! On l'aura dit. 
Suivant les couleurs et motifs qui créeront la pièce textile, les bobines sont ensuite choisies, ordonnées et embrochées à proximité du métier à tisser ... 
... et la carte perforée choisie, elle qui, de la même façon que sa cousine dicte la musique des orgues de Barbarie, ordonnera le ballet des aiguilles Bouchon ...  ... de ce métier Jacquard.
... de ce métier Jacquard.
 Ici, on fabrique des serviettes de bain, sur des métiers vieux comme, sinon le monde, parfois le siècle passé.
Ici, on fabrique des serviettes de bain, sur des métiers vieux comme, sinon le monde, parfois le siècle passé.
 L'automatisation a réduit les besoins de main d'œuvre. Les ouvriers, ici, surveillent et entretiennent les machines, s'assurent que les navettes sont toujours pleines et que pas une ligne de l'ouvrage n'est sautée. Pour limiter le nombre de serviettes jetées car tachées par les lubrifiants qui assurent la régularité de fonctionnement des pièces mécaniques mobiles, BTRA a proposé l'installation d'un circuit de lubrification fermé, actionné par une petite pompe manuelle reliée à quelques installations. Un coup de pompe et zou - l'huile est distribuée en quantité juste suffisante à tous les joints qui en ont besoin. Finies les acrobaties une burette d'huile à la main, finies les éclaboussures, et fini le gâchis de lubrifiant : le propriétaire est ravi.
L'automatisation a réduit les besoins de main d'œuvre. Les ouvriers, ici, surveillent et entretiennent les machines, s'assurent que les navettes sont toujours pleines et que pas une ligne de l'ouvrage n'est sautée. Pour limiter le nombre de serviettes jetées car tachées par les lubrifiants qui assurent la régularité de fonctionnement des pièces mécaniques mobiles, BTRA a proposé l'installation d'un circuit de lubrification fermé, actionné par une petite pompe manuelle reliée à quelques installations. Un coup de pompe et zou - l'huile est distribuée en quantité juste suffisante à tous les joints qui en ont besoin. Finies les acrobaties une burette d'huile à la main, finies les éclaboussures, et fini le gâchis de lubrifiant : le propriétaire est ravi.
 A quelques rues de là, c'est une fabrique de draps qui nous accueille. Ici, c'est l'électricité qu'on cherche à économiser, bien qu'elle soit très avantageusement subventionnée par le gouvernement.
A quelques rues de là, c'est une fabrique de draps qui nous accueille. Ici, c'est l'électricité qu'on cherche à économiser, bien qu'elle soit très avantageusement subventionnée par le gouvernement.

Les machines sont d'une complexité moindre que les métiers Jacquard utilisés pour tisser les serviettes. Elles semblent tout aussi vieilles. 
Dans l'allée voisine, ces rayures bleues nous rappellent quelque chose ... 
... ne seraient-ce pas les draps des Hôpitaux de France qu'on tisse dans cette ville moyenne à quelques heures de train de Mumbai ?  Draps ou serviettes, peu importe : après le tissage vient le contrôle qualité - et les derniers perfectionnements. Ici, une femme reprend quelques boucles peu régulières sur une serviette de bain, et en découpe les bords sans motif.
Draps ou serviettes, peu importe : après le tissage vient le contrôle qualité - et les derniers perfectionnements. Ici, une femme reprend quelques boucles peu régulières sur une serviette de bain, et en découpe les bords sans motif.

Pendant notre bref passage en Inde, on nous aura vanté la débrouillardise et l'économie des industries indiennes. Ici, les chutes des fuseaux presque évidés sont récupérées pour être, bout à bout, de nouveau embobinées.  Mais ce que souhaite nous montrer le Dr Matre, c'est surtout ce petit montage électrique : « l'Energy Saver Unit » mis au point par BTRA avec le soutien de l'Association indienne pour la recherche sur la conservation des énergies pétrolières (PCRA). Ce boîtier arrêtent les moteurs qui entraînent les métiers à tisser quand ceux-ci tournent à vide parce que le fuseau s'est dévidé, la navette a déraillé, la pièce à tisser est à changer ... Ce petit montage est crédité de 30% d'économies d'électricité - un gisement conséquent !
Mais ce que souhaite nous montrer le Dr Matre, c'est surtout ce petit montage électrique : « l'Energy Saver Unit » mis au point par BTRA avec le soutien de l'Association indienne pour la recherche sur la conservation des énergies pétrolières (PCRA). Ce boîtier arrêtent les moteurs qui entraînent les métiers à tisser quand ceux-ci tournent à vide parce que le fuseau s'est dévidé, la navette a déraillé, la pièce à tisser est à changer ... Ce petit montage est crédité de 30% d'économies d'électricité - un gisement conséquent !
 Photos de l'album "Sierra Nevada"
Chico. Une petite ville du Nord de la Californie. Le fief de la brasserie Sierra Nevada (SNBC), depuis 1979, témoin des premières expériences de son fondateur, Ken Grossman. 
Si la Pale Ale a fait la renommée de la Sierra Nevada Brewing Company (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé), ce sont surtout les efforts de l'entreprise pour améliorer le bilan énergétique de sa production qui nous attirent sur le terrain ensoleillé de ses usines. 
Cheri Chastaing est la responsable développement durable de la SNBC. Elle nous propose une visite qui nous en apprendra un peu plus sur le brassage de la bière - et sur les nombreuses actions qui en réduisent l'empreinte écologique. 
Ici, de magnifiques chaudrons de cuivre où malt, houblon et autres ingrédients magiques sont mis à mijoter pour offrir sa saveur à la bière. La SNBC fut l'un des premiers brasseurs américains à équiper ses grosses bouilloires de condenseurs de vapeur qui récupèrent la vapeur sinon perdue - et avec elle, la chaleur qu'elle emporte. 
Ces résidus solides du brassage (céréales, houblon, levure) iront enrichir la ration alimentaire de cheptels bovins voisins. 
Dans la bière, y a du moût (qui se dit wort en anglais). Et il est plutôt chaud, à en croire les indications de ce tuyau (notez qu'il s'agit de degrés Fahrenheit : 210°F = 99°C). 
Ici, le bas des cuves de fermentation. Le CO2, émis pendant l'étape de fermentation par les levures productrices d'alcool, est récupéré par la brasserie. Purifié, il est ensuite stocké pour être utilisé dans l'usine (il serait utilisé sur place pour nettoyer des verreries) ou vendu à d'autres producteurs de boissons. 
Vue de l'usine. 
En 2005, la SNBC a installé l'une des plus importantes centrales à pile à combustible des Etats-Unis (1 MW de puissance cumulée). Ces piles à combustible produisent une électricité peu polluante, et de la chaleur utilisée pour produire partie de la vapeur consommée par les opérations de brassage. 
La mise en bouteille. 
La « machine à coller les étiquettes ».  Remplies, encapsulées, étiquetées, les bouteilles se pressent en ordre rangé pour être ...
Remplies, encapsulées, étiquetées, les bouteilles se pressent en ordre rangé pour être ...
 ... empaquetées et acheminées vers l'entrepôt où elles attendront d'être emmenées vers le frigo d'un amateur de bière plutôt houblonnée.
... empaquetées et acheminées vers l'entrepôt où elles attendront d'être emmenées vers le frigo d'un amateur de bière plutôt houblonnée.

A cette étape de la production, l'optimisation s'appelle ... 
... réduction des déchets ... 
...et recyclage. 
Les palettes de bois sont réutilisées jusqu'à être inusables. Elles seront alors revendues, tout comme les déchets de carton et de papier, à une entreprise de recyclage voisine. Sachez que les étiquettes mal imprimées s'arrachent comme des petits pains à la boutique de souvenirs du hall d'accueil de l'entreprise : elles font de verdoyants blocs-notes ! 
Sur le parking de l'entreprise, des cylindres de béton sont prêts à accueillir suffisamment de panneaux solaires pour produire 500 kW d'électricité photovoltaïques, tout en procurant une ombre bienvenue aux voitures qui y seront garées.  Un peu plus loin, la SNBC cultive trois acres de houblon bio, décliné en plusieurs variétés qui sont ensuite utilisées dans la brasserie pilote où l'on teste de nouveaux mélanges, avant de les déguster sur le site et dans son restaurant.
Un peu plus loin, la SNBC cultive trois acres de houblon bio, décliné en plusieurs variétés qui sont ensuite utilisées dans la brasserie pilote où l'on teste de nouveaux mélanges, avant de les déguster sur le site et dans son restaurant.

Cheri nous fait part de l'excellente atmosphère que ces actions (et quelques autres) ont permis de créer dans l'entreprise. Nous nous étonnons que la SNBC ne fasse pas état de ces efforts pour gagner des parts de marché sur ses concurrents. Ce à quoi il nous est très légitimement répondu que bien que « vertes », la Pale Ale, la SummerFest, la Stout ou la Porter ne se vendront que si elles ont du goût.  Bien vu - « et bien vrai ! » vous diront les trois girls à bobs colorés
Bien vu - « et bien vrai ! » vous diront les trois girls à bobs colorés

Logo de la SNBC.  Photos de l'album "La Réunion"
La Réunion importe 86% de son énergie primaire. Parmi les produits énergétiques importés, les combustibles fossiles dont ont besoin ses réseaux de transport et lignes électriques figurent en bonne place - ici, le charbon, déchargé par camion dans la réserve qui alimente l'une des centrales électrogénératrices de l'île. 
L'une d'entre elle, mais pas n'importe laquelle. La centrale thermique de Bois-Rouge, comme celle du Gol, est fille de l'industrie sucrière. 
On n'y brûle pas que du charbon, ainsi qu'en témoignent les morceaux de paille qui tranchent sur les galets noirs. 
On y brûle aussi de la bagasse, ce résidu fibreux de la presse des cannes à sucre (dont le jus est extrait pour produire sucre, mélasse et rhum). La bagasse a toujours servi de source d'énergie à l'industrie sucrière, lui procurant chaleur puis électricité utile à en faire tourner les usines. L'excédent d'électricité est aujourd'hui revendu au gestionnaire du réseau électrique de l'île (EDF). Celui-ci s'accommodant mal de la saisonnalité de la culture de la canne qui prive les chaudières de Bois-Rouge de combustible pendant la moitié de l'année, il fut décidé d'en compléter le combustible par utilisation du charbon. 
L'entreprise, moins simple qu'elle n'y paraît, requit la conception de chaudières d'un nouveau genre, dont le régime de fonctionnement est suivi de près par un ensemble de senseurs. 
Il fait chaud près du foyer. 
Ouverture d'une vanne ... 
... qui donne sur la grille de combustion.  Bilan annuel : le charbon fournit 70% du combustible de la centrale, ...
Bilan annuel : le charbon fournit 70% du combustible de la centrale, ...

... et les fibres des champs de canne qui poussent à la porte de la centrale-sucrerie, les 30% restant.  |
| | Ce site est la déclinaison officielle de www.promethee-energie.com relative au livre "Le Tour du Monde des Energies". Tous droits réservés. |
|


