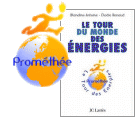
|
L'énergie nucléaire
Les photos liées au chapitre
Jose Luis Pérez était chercheur au CIEMAT (Madrid, Espagne) quand nous l'avons rencontré. Son passe-temps ? la vulgarisation sur l'énergie nucléaire. Créateur de petits films éducatifs, il contribue aussi à l'animation du site espagnol www.jovenesnucleares.org. Une tâche délicate tant le sujet est controversé ! 
Enrique Gonzales Romero, directeur de la division Fission Nucléaire du CIEMAT (Madrid, Espagne) nous a expliqué les méthodes envisagées pour gérer les déchets électronucléaires. Derrière lui, des tables de décroissance radioactive indiquent le chemin suivi par différents noyaux radioactifs pour expulser leur trop plein d'énergie et, avec le temps, se changer en noyaux stables. 
Ingjald Pilskog a récemment commencé un cursus de doctorat en physique nucléaire à l'Université de Bergen (Norvège). Il a aussi, pendant un an, servi comme délégué au bureau de représentation des étudiants au Parlement norvégien. Passionné par la proposition d'un consortium international pour mettre au point un réacteur au thorium (PEACE), il saura probablement mettre au service de cette expérience ses talents d'homme public ! 
Roche contenant du thorium (surfaces noires à reflets métalliques). 
Le professeur Egil Lillestol (à droite) anime avec l'un de ses collègues le séminaire de physique qui, les 29 et 30 janvier, était consacré au prototype d'amplificateur d'énergie pour une énergie propre (PEACE). Il a réuni chercheurs et représentants du secteur énergétique pour débattre des caractéristiques et des perspectives offertes par PEACE dans le contexte énergétique norvégien et européen. 
L'amplificateur d'énergie est constitué d'un accélérateur de protons (partie gauche), d'une cible dite de spallation génératrice de neutrons (éléments rouges à l'intérieur du réacteur schématisé à droite), et d'un réacteur sous-critique refroidi à l'eutectique plomb-bismuth (partie droite). Crédit : Yacine Kadi, CERN.  L'université de Tsinghua opère,
sur l'un de ses campus situés hors de Pékin un réacteur expérimental à haute température refroidi à l'hélium et modéré au graphite (Chine).
Construit en 1995, le HTR-10 a été rendu critique en 2000 et a pour la première fois fonctionné à pleine puissance (10 MW) en 2003.
Les réacteurs à haute température visent à augmenter les rendements de conversion de la chaleur dégagée
par les réactions de fission nucléaire en énergie électrique,
et surtout à offrir à certains processus industriels (dessalement de l'eau de mer, production d'hydrogène)
la chaleur à haute température qu'ils requièrent.
L'université de Tsinghua opère,
sur l'un de ses campus situés hors de Pékin un réacteur expérimental à haute température refroidi à l'hélium et modéré au graphite (Chine).
Construit en 1995, le HTR-10 a été rendu critique en 2000 et a pour la première fois fonctionné à pleine puissance (10 MW) en 2003.
Les réacteurs à haute température visent à augmenter les rendements de conversion de la chaleur dégagée
par les réactions de fission nucléaire en énergie électrique,
et surtout à offrir à certains processus industriels (dessalement de l'eau de mer, production d'hydrogène)
la chaleur à haute température qu'ils requièrent.
 Maquette du réacteur HTR-10 (High Temperature gas-cooled Reactor de 10 MW)
testé par les physiciens nucléaires de l'université de Tsinghua (Pékin, Chine).
A gauche, le réacteur dit à lit de boulets (pebble-bed reactor) ; à droite,
l'unité qui transforme la chaleur dégagée dans le réacteur par les réactions de fission nucléaires
et évacuée par le gaz au travers de la liaison entre les deux cuves en électricité.
On remarque que le cœur du réacteur n'occupe qu'environ un tiers de la cuve qui l'abrite et dans laquelle le gaz de refroidissement circule.
Il est rempli de boulets, qui mesurent chacun 6 cm de diamètre et sont faits d'un millier de particules TRISO emprisonnées dans une matrice de carbone
(qui joue le rôle de modérateur).
Celles-ci sont constituées d'une bille d'oxyde d'uranium entouré de plusieurs couches qui assurent l'étanchéité de la bille à l'échappement des gaz de fission,
la résistance mécanique de la bille, et son endurance à encaisser les variations de température dans le cœur du réacteur.
Maquette du réacteur HTR-10 (High Temperature gas-cooled Reactor de 10 MW)
testé par les physiciens nucléaires de l'université de Tsinghua (Pékin, Chine).
A gauche, le réacteur dit à lit de boulets (pebble-bed reactor) ; à droite,
l'unité qui transforme la chaleur dégagée dans le réacteur par les réactions de fission nucléaires
et évacuée par le gaz au travers de la liaison entre les deux cuves en électricité.
On remarque que le cœur du réacteur n'occupe qu'environ un tiers de la cuve qui l'abrite et dans laquelle le gaz de refroidissement circule.
Il est rempli de boulets, qui mesurent chacun 6 cm de diamètre et sont faits d'un millier de particules TRISO emprisonnées dans une matrice de carbone
(qui joue le rôle de modérateur).
Celles-ci sont constituées d'une bille d'oxyde d'uranium entouré de plusieurs couches qui assurent l'étanchéité de la bille à l'échappement des gaz de fission,
la résistance mécanique de la bille, et son endurance à encaisser les variations de température dans le cœur du réacteur.

Schéma de fonctionnement du réacteur HT-GR. Les flèches rouges représentent le mouvement du gaz chaud ; les vertes, celles du gaz dont la chaleur a été extirpée. 
Yannick Bénichou, étudiant français au département de génie nucléaire de Tsinghua, se fait expliquer par notre hôte le fonctionnement du réacteur sur lequel celui-ci travaille, avant de jouer au traducteur et de nous expliquer de quoi il retourne. Des informations (en anglais) plus précises sur le HTR-10 sont disponibles sur tauon.nuc.berkeley.edu/asia/1999/TPE99Xu.pdf 
Bien que le réacteur soit à l'arrêt lorsque nous lui rendons visite, nous suivons les règles qui permettent aux chercheurs de limiter la contamination radioactive. Nous chaussons ainsi d'élégantes sur-chaussures bleues, que nous jetterons avant de sortir pour ne pas emporter avec nous de poussières potentiellement radioactives. Elles viendront grossir le rang des déchets radioactifs. 
Antoine Cerfon, étudiant en thèse au Département de Science et Génie Nucléaire du MIT, nous fait visiter le laboratoire qui s'y intéresse à la fusion thermonucléaire. L'objet de ses recherches ? Le gyrotron auprès duquel il pose, un appareil conçu pour injecter au plasma de la chambre de fusion l'énergie qui lui permettra de se maintenir à la température requise pour que des réactions de fusion aient lieu (Cambridge, MA, Etats-Unis). 
Alcator est un petit réacteur de type tokamak, que les chercheurs du MIT (Etats-Unis) utilisent pour explorer les mystères de la fusion électronucléaires. Les écrans de contrôle reprennent les informations obtenues lors des décharges, dont l'une est imagée sur l'écran central (paradoxalement, c'est la partie la moins « chaude » du plasma qui est la plus « lumineuse »). 
Image de l'intérieur d'un tokamak, sur laquelle a été superposée une prise de vue obtenue lors de la décharge d'un plasma. Crédit : MIT/Nuclear Science and Engineering Department. 
Salle depuis laquelle les expériences menées dans le tokamak Alcator sont suivies (MIT, Cambridge, Etats-Unis).  A l'Université de Californie de Berkeley,
le professeur Per Peterson et les étudiants-chercheurs du laboratoire de thermo-hydraulique modélisent
le fonctionnement d'un réacteur à boulets refroidi non pas à l'hélium (comme le réacteur de Tsinghua), mais aux sels fondus.
Cette combinaison a les mêmes caractéristiques hydrauliques qu'un beaucoup plus petit bain d'huile rempli de billes en plastique d'un certain calibre
- qui sont bien plus faciles à se procurer et à étudier que le système réel.
Des bénéfices de la modélisation !
A l'Université de Californie de Berkeley,
le professeur Per Peterson et les étudiants-chercheurs du laboratoire de thermo-hydraulique modélisent
le fonctionnement d'un réacteur à boulets refroidi non pas à l'hélium (comme le réacteur de Tsinghua), mais aux sels fondus.
Cette combinaison a les mêmes caractéristiques hydrauliques qu'un beaucoup plus petit bain d'huile rempli de billes en plastique d'un certain calibre
- qui sont bien plus faciles à se procurer et à étudier que le système réel.
Des bénéfices de la modélisation !
 Le professeur Edward Morse tient un panneau décrivant quatre réactions de fusion.
Ce ne sont pas les seules physiquement possible, mais elles sont parmi les plus probables.
Les recherches actuelles portent sur la réaction entre le deutérium et le tritium,
qui génère 17,6 MeV d'énergie par réaction (Université de Californie à Berkeley, Etats-Unis).
Le professeur Edward Morse tient un panneau décrivant quatre réactions de fusion.
Ce ne sont pas les seules physiquement possible, mais elles sont parmi les plus probables.
Les recherches actuelles portent sur la réaction entre le deutérium et le tritium,
qui génère 17,6 MeV d'énergie par réaction (Université de Californie à Berkeley, Etats-Unis).

Le professeur Edward Morse nous explique que les très faibles taux de conversion de l'énergie électrique que reçoivent les lasers en énergie lumineuse utile pour sublimer la couche superficielle de cibles faites d'un mélange de deutérium et de tritium et initier leur fusion est un handicap important pour la fusion inertielle (Université de Californie à Berkeley, Etats-Unis). 
Vidéo : décharge d'un réacteur expérimental de fusion (Alcator)
Interview par OmegaTV - Energie : le nucléaire est-il dangereux ? |
| | Ce site est la déclinaison officielle de www.promethee-energie.com relative au livre "Le Tour du Monde des Energies". Tous droits réservés. |
|


